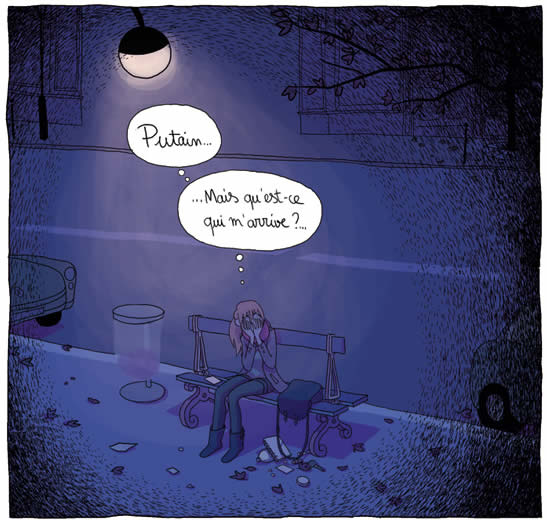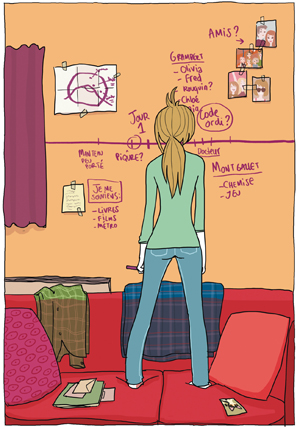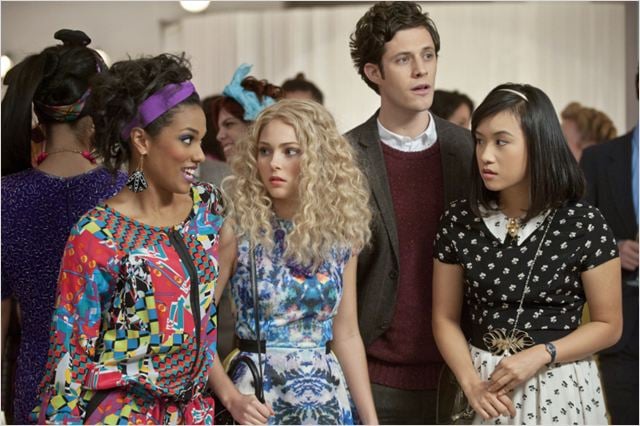L’Amante Anglaise
Questionner la
folie.
Acteurs : Laurence Boyenval,
Sylvain Marmorat, Christian Fregnet
Le
1er février dernier a eu lieu à Dijon la représentation de « L’Amante
anglaise » de Marguerite Duras, par la Compagnie « Le Rocher des Doms »,
mise en scène par Sylvain Marmorat. On peut relever que la mise en scène a été
élaborée sous les conseils avisés de Michael Lonsdale, acteur historique de la
pièce. En effet, il a interprété le rôle de l’interrogateur pour la première
fois dans une mise en scène de Claude Régy en 1968.
A
la fin des années 40, une femme, Claire Lannes, tue son mari et découpe le
cadavre en morceaux qu’elle disperse par la suite. De ce fait divers naîtra de
la plume de Marguerite Duras le roman L’Amante
anglaise, adapté par la suite pour le théâtre.
Dans le roman de Marguerite Duras, quelques éléments changent de
la réalité des faits. En effet, Claire Lannes n’assassine plus son mari mais
une cousine, sourde et muette, qui vit chez le couple. Elle découpe le cadavre
dont elle jette les morceaux dans des trains de marchandises du haut d’un
viaduc. La tête du cadavre reste introuvable… Recherchée, facilement arrêtée,
Claire reste incapable d’expliquer la raison de son crime.
La
pièce met en scène l’interrogatoire du mari, puis de sa femme. L’interrogateur
est le troisième personnage, dont on ne sait pas grand-chose, à part sa volonté
de comprendre Claire. Ni juge ni policier, il s’apparente davantage à un
psychologue ou à un journaliste, ayant pour tâche de délivrer la meurtrière de
ses maux par le biais de la parole.
« Je cherche qui est cette femme, Claire
Lannes.
Claire Lannes a commis un crime.
Elle ne donne aucune raison à ce crime.
Alors, je cherche pour elle. »
Un passé où
l’on a laissé la vie
Un présent
pour sombrer dans la folie
Cinquantenaire
sans enfant ni profession, Claire est mariée depuis 20 ans avec Pierre, mari
absent. Celle-ci en vérité vit dans le regret d’un amour passé et révolu. Avec
lui elle avait vécu pleinement, et la perte de ces sentiments passionnés et de
cette exaltation ressentis l’accompagne à chaque instant. Claire souhaite retrouver ce bonheur, et de
ce fait est incapable de se conforter de cette vie qui lui reste, construite
avec son mari actuel.
 Ce
besoin d’être aimé de nouveau s’accompagne d’un renfermement sur soi et d’une
communication entravée. Son mari, pourtant bien conscient du malaise installé,
ne fait pas grand-chose pour y remédier ce qui conforte alors Claire dans sa
solitude. Le principe selon lequel personne ne peut comprendre Claire devient
une vérité pour chacun des personnages, seul l’interrogateur se bât toujours
pour essayer de la comprendre.
Ce
besoin d’être aimé de nouveau s’accompagne d’un renfermement sur soi et d’une
communication entravée. Son mari, pourtant bien conscient du malaise installé,
ne fait pas grand-chose pour y remédier ce qui conforte alors Claire dans sa
solitude. Le principe selon lequel personne ne peut comprendre Claire devient
une vérité pour chacun des personnages, seul l’interrogateur se bât toujours
pour essayer de la comprendre.
Le
quotidien de cette femme se compose alors de journées et de nuits passées sur un banc dans le jardin. Sans personne pour la déranger, sans les regards de sa
cousine ou l’odeur dérangeante de sa cuisine, sans le silence pesant de son
mari complétant le sien. Ainsi c’est dans cette solitude intense dans le jardin
que Claire peut se sentir paisible, parce qu’elle pense à son passé et qu’elle
communique alors avec elle-même, à défaut de pouvoir communiquer avec les
autres. Cependant, dire qu’elle se satisfait de ce quotidien serait une
conclusion hâtive. A un moment, celle-ci déclare se sentir morte depuis
qu’elle habite avec son mari, dans cette maison. Alors, pour elle, vivre ainsi est-ce
vraiment vivre?
L’interrogatoire
du mari, ouvrant la pièce, est très important. Marguerite Duras, en parlant de
celui-ci, écrit qu’ « il était aussi
sourd et muet que la victime : c’est la petite bourgeoisie française, morte
vive dès qu’elle est en âge de penser, tuée par l’héritage ancestral du
formalisme. » Ainsi, Pierre Lannes
est aussi sourd et muet que la victime. « Il ne s’est jamais réveillé » dit de son côté sa femme. C’est seulement par le biais de cet entretien
avec l’interrogateur que Pierre Lannes comprendra que c’est lui seul que sa
femme aurait dû tuer. L’horreur apparaît alors : cette révélation lui fait
prendre conscience de toute son impuissance, mais également de sa culpabilité dans
ses évènements. C’est la pensée du crime, de l’acte de tuer, comme l’idée que
l’on tue lentement la personne avec laquelle on vit dans un quotidien fermé, à
l’intérieur duquel on se tue également soi-même tous les jours. Alors la
tragédie émerge de l’horreur, fondant la force de ce drame.
L’actrice
(Laurence Boyenval) rend le personnage de Claire poignante, juste, touchante et
insaisissable à la fois. Piégée dans ce qu’elle ne peut expliquer, épuisée de
ne pas comprendre ses agissements, celle-ci est en réalité poussée par une
folie qu’elle finit par reconnaître.
Vivre dans la mémoire du temps où l’on a été aimée
Claire
est en demande d’amour, d’attention, qu’elle n’arrive pas à exprimer. Elle
souhaite retrouvée l’amour perdu, immortalisé en sa mémoire pour ne plus jamais
la quitter. De ce fait, cloîtrée dans sa solitude, hantée par ses souvenirs, tout
se mélange : ses pensées sont emprisonnées d’après elle, et n’arrivent
plus à sortir. Tout ce qu’elle ne supporte pas alors chez les personnes avec
qui elle vit restent des non dis… qui la torturent. Comment gérer cela ? En
définitive, Claire est un être humain qui frise sans s’en douter la folie, qui
mélange la folie et l’amour, l’amour qu’elle a eu dans sa vie, qu’elle est prête
à avoir encore maintenant. Déconnectée de la réalité Claire finira alors par
commettre le meurtre, fatal. Et un mystère certain demeure.
« La
folie exerce sur moi une séduction, c’est à l’heure actuelle le seul véritable
élargissement de la personne, dans le monde de la folie, il n’y a rien, ni
bêtise, ni intelligence, c’est la fin du manichéisme, de la responsabilité, de
la culpabilité. Claire Lannes a derrière elle ce qui a donné de l’importance à
sa vie : l’amour. Son centre de gravité s’est déplacé, il est d’habitude
en avant de nous dans l’avenir, chez elle il est dans le passé alors c’est
merveilleux.» Marguerite
Duras
Avec
la force des mots de son auteur, cette pièce nous entraîne dans une tentative
d’analyse du comportement d’êtres insaisissables. L’œuvre devient alors une
quête de l’intime humain, quête de la vérité des êtres seuls et fous, de
leurs souffrances, de leur étrangeté et surtout, de leur besoin d’amour.